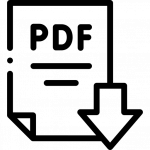Le duo Laura Bottereau & Marine Fiquet dessine un univers aussi séduisant que répulsif, associant de manière dérangeante, mais assumée, jeux infantiles et marqueurs libidinaux. Déconstruction plastique de l’enfance, cette oeuvre affiche néanmoins une retenue, voire une pudeur, paradoxale qui donne à leur propos la tonalité d’une douce insolence. Leur prolifique fantasmagorie saisit ainsi l’extraordinaire plasticité de l’enfance, cette « période critique » pour reprendre un terme de neurosciences, qu’elles envisagent comme un état transitoire, explosif, et souvent mal compris. Aussi les plasticiennes assument-elles la position d’un réalisme d’ordre psychanalytique ; elles désubliment la vision de l’enfance pour la restituer dans ce qu’elle a de moins glorieux, de la tendance au sadisme à l’expression de ses pulsions égoïstes.
Tout autant graphique que dramaturgique, leur oeuvre se situe entre un dessin théâtralisé et des mises en scène illustrées. La collusion entre une apparence immédiatement lisible et des réseaux de sens cachés plus complexes crée des effets de rupture qui en multiplient les interprétations. Leurs protagonistes relèvent d’une même esthétique de l’ambiguïté. Le plus souvent nus comme neutralisés, ces personnages anthropomorphes empruntent leurs caractéristiques conjointement à l’adulte et à l’enfant. Monstres humanoïdes, au genre et à l’identité troublés, ils font coïncider plasticité libidinale, psychique et corporelle sur la scène de leurs propres métamorphoses.
La série de dessins S’Horrifier de l’Orifice s’inspire directement des Guérillères de Monique Wittig, un essai-fiction qui décrit la vie en communauté d’une société exclusivement féminine, réinterprétation contemporaine du mythe des Amazones. Laura Bottereau & Marine Fiquet se réfèrent plus spécifiquement à un passage durant lequel Wittig décrit un rapport ludique à la vulve, un geste d’auto-affectation qui désinhibe autant le plaisir qu’il débride l’imagination : « Elle se laisse tomber par terre alors en demandant qu’on la distraie. On lui raconte avec beaucoup de détails l’histoire de celle qui, parlant de sa vulve, a coutume de dire que grâce à cette boussole elle peut naviguer du levant au couchant. » Á première vue, le dessin illustre une communauté de jouissance, prenant place dans une utopie féministe. Les corps de plusieurs jeunes femmes sont entrelacés les uns aux autres, formant un cosmos saphique. Il peut également être lu comme une métaphore de l’auto-érotisme et de ses multiples actualisations, une illustration de l’érogénéité du corps propre comme étape nécessaire de la construction identitaire.
Associant le sexe à l’effroi, son titre, S’Horrifier de l’Orifice, inscrit le propos dans une interprétation bataillienne en même temps qu’il fonctionne sur le modèle du jeu de mots lacanien. L’allitération en « or » évoque ainsi le métal précieux — associant l’imaginaire alchimiste au motif d’une métamorphose — autant que l’« oral », le lieu buccal à la fois sexuel et langagier. La composition du dessin accorde enfin une place particulière à un motif prépondérant de la pensée de Witttig, le trou originel : « Elles disent que de son chant on n’entend qu’un O continu. C’est ce qui fait que ce chant évoque pour elles, comme tout ce qui rappelle le O, le zéro ou le cercle, l’anneau vulvaire. » Suggéré à travers l’image de la planète ronde, comme un monde en soi, une sphère aux infinies circularités, le sexe féminin est rendu à sa béance infinie, prenant ironiquement la forme de l’ouroboros, du serpent qui se mord la queue.
L’installation Martyr(e)s met en scène trois personnages à taille d’enfant : deux figurent des bourreaux (les visages couverts, ils sont en situation de domination), le troisième la victime (la veste ouverte, il accueille les blessures), transpercé de flèches à la manière d’un saint Sébastien. La scène joue sur l’ambiguïté entre une cour de récréation, un tribunal improvisé et une partie de chasse, et exprime la violence désinhibée de l’enfance, ici les mécanismes de bouc-émissaire, jusqu’au lynchage collectif, par lequel un groupe s’autorégule et assure sa cohésion. Cette image d’un processus proto-social rappelle par la même occasion ce travail à l’histoire du théâtre, dont les premières formes helléniques émergeaient d’un rituel sacrificiel. Le titre est porteur d’une ambiguïté qui dédouble l’expérience de lecture que l’on peut en faire. Le « e » entre parenthèses sert en effet de point de bascule entre deux perspectives opposées : le regardeur peut se placer du côté du martyr (sans « e »), il est alors face à une victime pour laquelle il peut nourrir empathie ou compassion, ou considérer le martyre (avec un « e »), la scène en entier, d’une façon plus détachée, d’un œil observateur qui en appelle à une pulsion scopique (à notre tendance à se satisfaire d’images effroyables, de cadavres, d’accidents etc.).
La référence au martyr assume une position iconoclaste quant à la tradition hagiographique. Il s’agit en premier lieu de poser la cruauté originelle de l’homme en regard de celle de certains épisodes du récit biblique, et d’en souligner les paradoxes. La souffrance endurée au nom de la foi apparaît ici comme salvatrice et glorieuse, quand elle semble pudiquement condamnée dans les cours de récréation et les espaces publics. La violence n’est ni feinte, ni dissimulée, elle est la valeur de transfert par laquelle opposer pulsions infantiles et sublimation chrétienne. Martyr(e)s rappelle ainsi à la cruauté des épisodes bibliques et à son absurde autojustification : l’agonie des saints leur assurant la reconnaissance divine, à l’instar de saint Apolline, à qui l’on arracha les dents une à une, ou de sainte Dymphna, décapitée par son père qui voulait l’épouser. Le choix du saint Sébastien renvoie également à son statut d’icône homoérotique. Conformément à sa signification chez des écrivains plus ou moins subversifs (Tennessee Williams, Garcia Lorca, Mishima, Wilde, Proust…), son évocation contribue ici à réhabiliter la figure de l’homosexuel dans l’histoire des imaginaires collectifs.
Deutéronome 22:5 est un dessin unique qui représente deux filles, un garçon, même si on ne peut être sûrs de ces assignations de genre. Chacun s’amuse à se déguiser en l’autre sexe : maquillage pour le garçon, blouson et jean pour la jeune fille, chaussures d’adultes pour la dernière. On pourrait s’en tenir au dessin d’une scène domestique, celle d’enfants s’amusant à se travestir, un jeu commun dont on retrouve plus tard les traces dans les carnavals, le marivaudage, le travestissement de cabaret ou la performance queer. Néanmoins, l’indication du titre (la référence à un passage de l’Ancien Testament) annonce clairement une intention iconoclaste. Laura Bottereau & Marine Fiquet tournent en dérision l’interdit biblique en soulignant le décalage entre jeux d’enfants et la sévérité du jugement religieux : « 22:5 – Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. » Cette opération trouve d’ailleurs toute sa légitimité si l’on prend en compte d’autres interdits énoncés dans le Deutéronome à la légitimité douteuse, à l’image de la prescription absurde du livre 22:11 qui interdit le port de vêtement synthétique ou de la combinaison de deux textiles : « Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. »
Au-delà de l’herméneutique critique du corpus religieux, l’oeuvre rappelle le genre sexuel à son indifférenciation première durant l’enfance. La psychanalyse et, en creux, la biologie sont alors convoquées comme des paroles d’opposition au dogme chrétien, rationalisant un comportement considéré comme déviant. Ainsi les plasticiennes peuvent-elles se prévaloir des travaux de Léopold Szondi sur la question de l’androgynie ou de l’hermaphrodisme originel de la cellule vivante (« Tout homme a été cet être double dans la phase la plus ancienne de son ontogenèse, comme cellule sexuelle primaire (ovocyte ou spermatocyte) ») ou de ceux de Lacan qui démystifie avec la notion de « transvestisme » l’identification du garçon à la mère ou de la fille à la figure phallique qui lui manque. Le propos sur la construction du genre réinscrit ainsi la question dans le champ de la performativité et ramène une fois de plus l’oeuvre dessinée à sa dimension théâtrale. Réminiscence du travestissement des hommes dans le théâtre de l’Antiquité, cette scène de jeu enfantin réarticule les premières formes de théâtre à leurs conditions psychologiques, bien au-delà de la condamnation morale.
Mouvement perpétuel réunit deux personnages à taille d’enfant en un sens difformes car affublés de membres d’adultes. Moulés d’après les corps des artistes, les mains en plâtre et les masques de porcelaine font des mannequins des alter-egos de Laura Bottereau & Marine Fiquet, même si leur neutralité générale permet à chacun de s’y projeter. Les protagonistes sont reliés l’un à l‘autre par une corde, placée à l’endroit de leurs organes génitaux, que le spectateur peut activer à l’aide d’une manivelle. Au premier abord, on pourrait croire à une innocente partie de corde à sauter, à laquelle le spectateur pourrait nostalgiquement participer, si l’activation du mécanisme par le spectateur ne produisait pas, en second lieu, l’effet d’une charge sexuelle mêlée d’un sentiment de blesser ou de malmener les mannequins, par frottement ou friction de la corde contre la chair intime. L’association de la violence et du sexe plaide ici encore pour une mise en scène de la jouissance au sens lacanien : cette disposition affective où l’horreur se mêle au plaisir, allant selon la formule du psychanalyste de la chatouille à l’immolation.
Leur titre associe le mouvement perpétuel, le principe d’un mouvement cosmique éternel, à un motif libidinal, celui de la pénétration répétée, dans une dialectique aussi vaine que jubilatoire. Image désabusée de la mécanique procréatrice comme de la répétition d’un geste qui confine à la torture, Mouvement perpétuel joue de l’ambiguïté entre le viol, par définition non-consenti, et la scène sadomasochiste, le jeu volontairement blessant. Rappelant l’humain à la perversion polymorphe de son enfance, Laura Bottereau & Marine Fiquet en démystifient l’innocence supposée, et profitent de l’ambiguïté affective produite pour affirmer la nécessaire ambivalence de la pulsion infantile, la balance perpétuelle entre le plaisir de soi et la jouissance de l’autre.